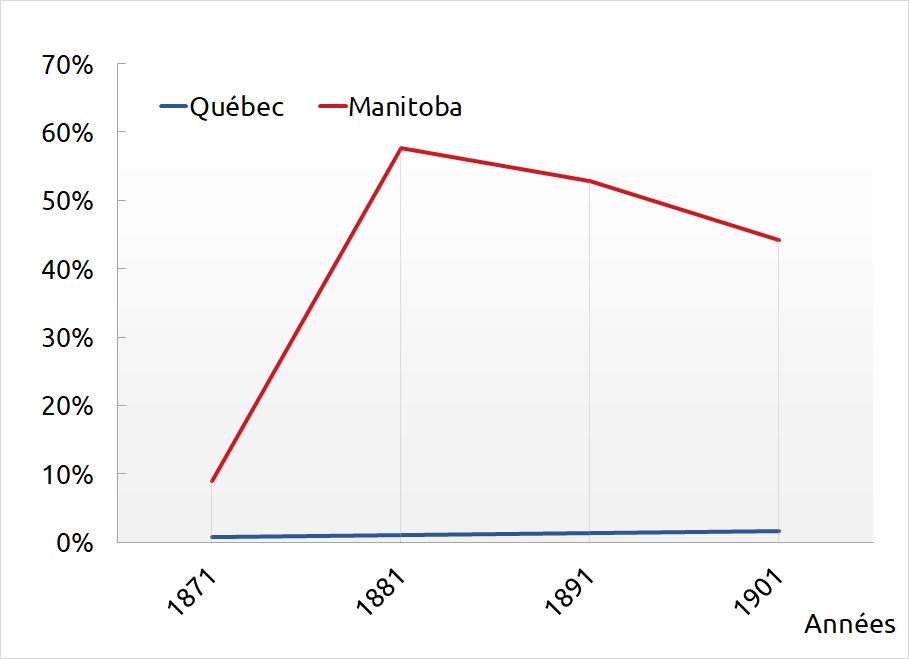Dossier documentaire 1840-1896 (version A)
3. Section C
Document 1 : Discours de John A. Macdonald (1878)
« [L]a prospérité du Canada requiert l’adoption d’une politique nationale qui [...] bénéficiera et favorisera les intérêts agricoles, miniers, manufacturiers et autres du Canada; que cette politique gardera au Canada des milliers de nos compatriotes maintenant obligés de s’expatrier pour trouver du travail qui leur manque dans la patrie, rendra la prospérité à nos industries qui luttent et souffrent si péniblement [...]. »
Source : John A. Macdonald, « Débat du 13 mars 1878 (extrait) », Journaux de la Chambre des communes du Canada, 3e législature, 5e session, Ottawa, MacLean, 1878, p. 78, en ligne sur Canadiana.
Document 2
« [Le] principe fondamental consiste à encourager [...] le développement de l’industrie canadienne : d’une part, on permet l’entrée au pays de matières premières à bas prix, comme le coton, la laine, le sucre brut, la mélasse; d’autre part, on impose des droits de douane élevés (25 à 30 %) sur les produits qui peuvent concurrencer les produits canadiens comme les tissus de coton ou de laine, le sucre raffiné, les clous, les vis, les moteurs. »
Source : Craig Brown, Histoire générale du Canada, Montréal, Boréal, 1990 p. 408-410.
Document 4
« La Politique nationale de 1879 fut le plan directeur du gouvernement fédéral qui revendiquait l’intégration de l’Ouest et une intégration à la structure dont le cœur est le Canada central. Cette politique [vise,] en premier lieu, le prolongement du chemin de fer qui permet de transporter des marchandises et des passagers sur l’axe est-ouest [...]. »
Source : Henry H. Hiller, « La sociologie et la construction de la nation au Canada anglais : la contribution de l’Ouest canadien », Cahier de recherche sociologique, no 39 (2003) p. 56-57, en ligne sur Érudit.
Document 5
« Comme résultat de cette Politique nationale, l’industrie manufacturière se développa rapidement et se concentra dans les provinces centrales : Ontario et Québec. Les régions plus excentriques continuèrent à développer leur agriculture, leurs forêts et les autres ressources de leur secteur primaire, mais les progrès proprement industriels y furent relativement lents. Des relations d’échange s’établirent entre les régions rurales et les centres manufacturiers, entre les provinces du centre et les autres provinces [...]. »
Source : Yves Dubé, « Quelques aspects de la politique des transports au Canada », Étude présentée au treizième congrès annuel de l’Institut d’Administration Publique du Canada, 1962, p. 98, en ligne sur Wiley Online Library.